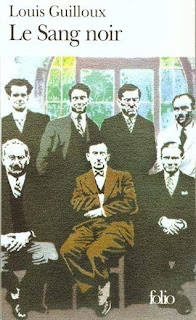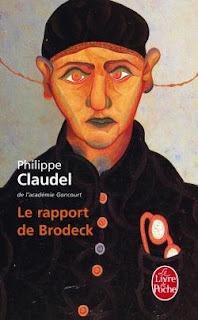Louis Guilloux, Le Sang noir, Gallimard
Mon coup de coeur :
Récit d'une journée de 1917 dans une ville de province épargnée par les combats et portrait sans concession des ses habitants, Le Sang noir est un roman brillant qui nous transporte dans un univers à la fois tragique, burlesque et quasi fantastique.
La figure principale de ce récit est Merlin le professeur de philosophie à l'allure grotesque et au sobriquet ridicule: Cripure (la Critique de la raison pure de Kant devenant pour ses élèves la "Cripure de la raison tique"). Moqué par ses lycéens, il est aussi la risée de ses collègues et de ses concitoyens. Même son narrateur ne l'épargne pas:
"Son petit chapeau de toile rabattu sur l'oeil, sa peau de bique flottante, sa canne tenue comme une épée, et cet effort si pénible à chaque pas pour arracher comme d'une boue gluante ses longs pieds de gugusse, Cripure avait l'air dans la rue d'un somnolant danseur de corde. Sa myopie accusant le côté ahuri de son visage, donnait à ses gestes un caractère ralenti, vacillant, d'ivrogne (...)"
Vivant en marge de cette société dont il ne reconnaît pas les valeurs, Cripure partage sa vie avec Maïa -sa concubine illettrée au physique ingrat- et ses chiens à puces. Déjà auteur de deux livres il ne rêve que d'en écrire un autre, un chef-d'oeuvre, un recueil de pensées appelé "Chrestomathie du Désespoir -tel était le titre pédantesque qu'il comptait lui donner, à moins qu'il ne l'appelât : La Mistoufle..."
Autour de lui se greffent d'autres personnages tous malveillants, hypocrites et fantoches à l'image de Nabucet, médiocre petit notable franchouillard et inculte : "Cripure avait déçu l'assemblée en parlant avec trop de flamme d'un écrivain étranger, un certain Ibsen dont il semblait tout féru. Même alors, et qu'eût-ce donc été aujourd'hui, cette exaltation d'un étranger leur avait semblé incongrue. Elle témoignait de sentiments hostiles à la culture française. Que diable, mais que diable avait-on besoin de tous ces Suédois et autres métèques (...) Est-ce qu'en littérature comme en tout, ces gens-là n'étaient pas de plats imitateurs de la France ?".
Alors que sur le front les combats se poursuivent et que les premières mutineries éclatent, ces derniers consacrent leur temps à des mondanités et à se gargariser de discours patriotiques auxquels ils ne croient pas. Bouffis d'orgueil, ils restent aveugles à ce qui se passe autour d'eux. Or au-delà de cet apparat la seule réalité tangible, la chose qui compte le plus c'est la mort des soldats et la douleur et les larmes de leurs proches.. Quel passage émouvant et plein de pudeur que celui consacré à M. Marchandeau dont le fils vient d'être exécuté. Jusqu'à présent cet homme avait eu "le sentiment que cela ne le concernait pas directement, que les choses se passaient dans un univers sans rapport avec le sien, si paisible, que bien sûrement il ne serait jamais fusillé, lui ni personne qu'il connût. Or...". Dupé par la propagande officielle, Mr Marchandeau s'étonne qu'il puisse y avoir des insurgés et qu'on puisse les abattre comme des traitres. Involontairement complice de cette "machine meurtrière" qui maintenant se retourne contre lui et les siens, il avait longtemps cru "que ces milliers de jeunes gens jetés au fumier acceptaient joyeusement leur mort". Quelle terrible désillusion!
Le Sang noir est un roman typique des années 30 qui fait de l'Histoire un élément essentiel de l'intrigue sans que cela se fasse au détriment des personnages. D'ailleurs si Guilloux peint un portrait aussi saisissant de Cripure c'est afin d'en faire le révélateur de la société dans laquelle les personnages évoluent (mais aussi un rempart contre cette même société): une société sans repère ni valeur. La présence d'un tel personnage permet de dénoncer la frivolité, l'indélicatesse et la suffisance d'une certaine classe sociale qui a pu rester loin des combats.
La satire est cruelle et les dimensions politiques et métaphysiques rendent ce roman inoubliable. Dès les premières pages il interpelle et fascine (tout comme Cripure) et déroule une intrigue à la beauté dramatique. Je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années pourtant il continue de m'émouvoir et me fasciner.
Louis Guilloux (1899-1930) est un écrivain incontournable des années 30. Ce roman (publié en 1935) fut lu et défendu par André Gide, Jean Grenier, André Malraux (son ami) et Albert Camus (son élève). Ce dernier à propos de ce roman disait: "Ce livre tendu et déchirant qui mêle à des fantoches misérables des créatures d'exil et de défaite, se situe au-delà du désespoir et de l'espoir".
Son oeuvre pourtant magistrale et influente est de nos jours tombée dans l'oubli. Pourtant chaque année un prix portant son nom est remis par le Conseil des Côtes d'Armor pour "une oeuvre de langue française, caractérisée notamment, outre l'excellence de la langue, par la dimension humaine d'une pensée généreuse refusant tout manichéisme, tout sacrifice de l'individu au profit d'abstraction idéologique".
Ses convictions humanistes ont d'ailleurs conduit Guilloux à occuper le poste de secrétaire lors du 1er Congrès mondial antifasciste. Lui même se considérait comme avoir "toujours été dans une philosophie de gauche socialisante et même communisante, mais il y a un côté anarchisant lié à l'écriture qui est vraiment mien".
Cet ancien élève et admirateur de Georges Palante -de qui il s'inspira pour créer Cripure- a reçu le prix Renaudot en 1949 pour son roman Jeu de patience.
Et plus si affinités :
J'ai trouvé sur internet deux articles consacrés à Louis Guilloux qui complètent le portrait sommaire que j'ai pu faire de lui. Je vous laisse naviguer ici ou là au gré de vos envies.
Et toujours plus :
"Je n'ai pas d'idéal social. Je crois que toute société est par essence despotique, jalouse non seulement de toute supériorité mais simplement de toute indépendance et originalité. J'affirme cela de toute société quelle qu'elle soit, démocratique ou théocratique, de la société à venir comme celle du passé et du présent. Mais je ne suis pas plus fanatique de l'individu. Je ne vois pas dans l'individu le porteur d'un nouvel idéal, celui qui incarne toute vertu."
Georges Palante (1862-1925) est un sociologue et philosophe français admirateur de Nietzsche et lecteur de Freud. Il appartient à un courant philosophique défendant "l'individualisme aristocratique" selon lequel un individu doit pouvoir vivre en société sans pour autant être broyé par elle.
Sa postérité est assurée notamment par Guilloux, Grenier, Camus (le nom de Palante figure dans L'homme révolté), Gide (qui le cite en exergue dans Les Caves du Vatican) et actuellement par Michel Onfray qui lui a consacré son essai Physiologie de Georges Palante, pour un nitzschéisme de gauche initialement paru aux éditions Folle avoine et réédité chez Grasset en 2002.